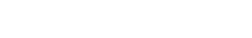OFFICE Kersten Geers David Van Severen
Il n’y a rien de plus difficile dans la vie que de dire au revoir à un être cher. L’endroit où cela se déroule peut certainement influencer ce processus de deuil. Ce n’est donc pas une mauvaise idée d’impliquer des architectes dans la création d’un crématorium. Ils l’ont bien compris à Ostende. Avec le crématorium Polderbos, le BUREAU Kersten Geers David Van Severen a conçu bien plus qu’un bâtiment. Intégrés dans un paysage cérémonial, les visiteurs peuvent y dire au revoir en toute dignité.
Lorsque l’intercommunale OVCO ‘Polderbos’ a lancé un appel d’offres pour la construction d’un nouveau crématorium à Ostende, le BUREAU Kersten Geers David Van Severen n’a pas seulement pris part à l’offre, mais a aussi impliqué l’artiste Richard Venlet et l’architecte paysagiste Bureau Bas Smets. Ils ont immédiatement vu le potentiel de l’utilisation du magnifique paysage des polders et ont été les seuls à ne pas placer le bâtiment du côté de la rue dans leur conception, mais plus profondément dans le paysage, telle une sculpture. Le bâtiment et le paysage sont pour eux des composantes égales dans l’élaboration de ce rituel d’adieu. « Nous avons effectivement placé le bâtiment dans le paysage, loin de la rue où se trouvait la briqueterie. Plutôt qu’un simple bâtiment, nous voulions concevoir un paysage cérémonial dans lequel toutes les fonctions associées aux adieux, comme la crémation et la dispersion, étaient réparties sur le site. L’intention est que les visiteurs traversent ce paysage pour chacune des composantes de l’au-revoir. »
Le bâtiment lui-même a un design très particulier et abstrait, fort différent de ce à quoi nous sommes habitués pour des crématoriums. C’est ce que l’on obtient quand on laisse des architectes et un artiste s’en occuper. Pourtant, c’est tout sauf une déclaration d’art gratuite. La conception est venue de manière très réfléchie, en formulant une réponse à la question que posait ce bâtiment. « D’une part, c’est un bâtiment public important dans lequel des personnes se disent adieu, mais d’autre part, à cause de la crémation, c’est aussi un bâtiment très technique et presque industriel avec des incinérateurs et des installations techniques. La question que nous nous sommes posée était de savoir comment réunir ces différentes fonctions sans que l’une soit gênée par l’autre. Notre solution était de placer toutes les fonctions littéralement sous un même grand toit. Un toit en pente qui apparaît comme la cinquième façade dans le paysage (ou comme la seule façade lorsque vous êtes plus loin). En plaçant le toit en pente, nous avons pu créer ainsi des zones plus intimes à l’avant. Plus on pénètre profondément dans le bâtiment, plus les espaces deviennent monumentaux. Des zones intimes sont désignées pour l’accueil des visiteurs, des espaces en double hauteur pour la fonction technique. »
Dans ce bâtiment où la toiture joue le premier rôle, la conception de cette dernière est très importante. Dans l’intention de traduire formellement son contenu particulier, il a été conçu en collaboration avec Richard Venlet comme un instantané ou une « nature morte ». « Le toit se caractérise par une composition de lucarnes et de formes abstraites qui répondent à la fois aux exigences techniques et symboliques des espaces sous-jacents. Ainsi, la lumière du jour pénètre dans le foyer et les deux grandes coupoles sculpturales éclairent à la fois la petite et la grande salle de cérémonie. Cette composition nous a permis de dissimuler la cheminée des incinérateurs dans une sorte de mur qui dépasse sous le toit, de sorte qu’on ne puisse plus la voir depuis le toit. »
Sous ce toit en pente particulier, on retrouve un mélange d’espaces publics et de cérémonie ainsi que des fonctions administratives et techniques sur un seul niveau. Ceux-ci sont organisés en bandes longitudinales de différentes largeurs. Dans la première bande, on retrouve la zone d’accueil sous le point le plus bas du bâtiment comme l’espace le plus intime pour que les visiteurs puissent se retrouver dans un lieu à échelle humaine. Les deux salles de cérémonie situées au centre et pouvant être reliées entre elles forment la deuxième bande et dans la troisième et dernière bande, l’espace du four et les locaux techniques sont aménagés sous le point le plus élevé du toit. En guise de tampon, ces trois bandes principales alternent avec des bandes plus étroites qui ont des fonctions de support et des passages comme les sanitaires. Les sections cérémonielle et technique sont aussi séparées thermiquement et techniquement du feu.
La relation entre les différents espaces et le paysage environnant est indirecte et filtrée à travers une double façade de verre et de panneaux perforés, créant ainsi une atmosphère discrète et sereine dans les salles de cérémonie. La torsion entre les espaces longitudinaux et le plan du toit crée une série d’espaces extérieurs couverts de différentes hauteurs, bordés par une colonnade constituée de colonnes rondes soutenant l’immense dalle de toit. Cela se fait aussi via les structures en acier des façades transversales qui sont revêtues d’un côté de verre et de l’autre de panneaux d’aluminium perforé. « L’idée est de créer à l’intérieur une sorte d’intimité qui permet de regarder vers l’extérieur, mais pas de l’extérieur vers l’intérieur afin de maintenir l’intimité.. D’où la création de ces façades doublées avec les panneaux perforés qui pendent devant les baies vitrées comme des rideaux d’acier. Pendant la journée, ils fournissent une lumière filtrée à l’intérieur et le soir, on obtient une impression de l’extérieur de ce qui se passe à l’intérieur. »
L’acoustique a aussi nécessité une approche spécifique dans un bâtiment en béton. Les cloisons de séparation entre les deux pièces ont par exemple été finies en tissu/mousse en fonction de l’acoustique de la pièce. Dans ces murs qui séparent acoustiquement les pièces les unes des autres, les techniques courent aussi au sommet. En plus, les évidements dans les murs en béton qui s’élargissent au fur et à mesure que les murs s’élèvent sont comblés de différentes manières, mais toujours endéans un cadre en bois. Il peut par exemple s’agir d’une porte d’entrée vitrée, d’un canapé ou d’une porte d’entrée avec panneau de remplissage acoustique. De cette façon, ils pouvaient tout intégrer dans l’architecture et le mobilier. La ventilation, par exemple, est envoyée dans la pièce via des grilles en bas des bancs. Le chauffage du bâtiment se fait de manière très durable. En effet, la chaleur résiduelle produite par les fours est utilisée à cette fin.
La neutralité et la sérénité recherchées par le bâtiment sont renforcées par la matérialisation. Le béton prend le dessus, à l’intérieur comme à l’extérieur. Alors que les dômes ont été finis à l’extérieur avec du béton projeté, à l’intérieur ils sont pourvus d’un enduit acoustique grossier. Contrairement à l’extérieur, on obtient une histoire plus douce à l’intérieur. Les murs longitudinaux ont été coulés sur place en béton apparent, en utilisant des panneaux de bois comme coffrage perdu. D’où la texture du bois et le dessin dans le béton qui confèrent à l’intérieur une certaine douceur. « Cette douceur et l’intégration de la couleur, ainsi que la recherche d’une bonne acoustique, étaient la raison pour laquelle les textiles ont été fréquemment utilisés comme touche finale. Il en va de même pour les dossiers des canapés et pour tous les meubles sur mesure conçus avec Richard. Chaque bande a sa propre utilisation de la couleur qui se reflète entre autres dans les portes. L’utilisation de couleurs et de textiles offre un certain contrepoids aux surfaces de béton rugueuses et dures. Dans les parties communes, cela s’applique aussi aux parquets en bois qui ajoutent une touche chaleureuse. Bien que nous ayons travaillé avec des sols en béton dans les zones d’appui et techniques, en y ajoutant un pigment de couleur argile, il semble venir tout droit du sol et fonctionne très bien avec le bois en contraste avec le béton.
Concevoir des crématoriums est un phénomène assez récent, mais avec le Polderbos, OFFICE Kersten Geers David Van Severen prouve qu’il existe certainement une plus-value architecturale. « Grâce à la collaboration intégrée avec l’artiste Richard Venlet, nous avons réussi à créer un endroit agréable où les gens peuvent faire leurs adieus avec dignité. Et puis on voit surtout l’implantation sur le site dans le cadre du paysage cérémonial comme la plus grande réussite. C’est une approche unique qui transcende presque sa fonction. Le bâtiment lui-même a ses propres qualités, une apparence positive et est étroitement lié à son environnement. Cela en fait un endroit agréable sans avoir à évoquer une association directe avec la mort. Il est bon de noter que les salles du bâtiment peuvent aussi accueillir d’autres fonctions comme des conférences ou de petits concerts. »
Texte: Sam Paret
Photos: OFFICE 165 Crematorium © Bas Princen