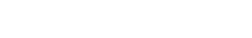Stéphane Beel Architects
Un dialogue contemporain avec le contexte historique insuffle une nouvelle vie au musée
Comment gérer, en tant qu’architecte, un projet qui non seulement abrite un site protégé, mais dont l’histoire est également chargée? C’est la question que s’est posée Stéphane Beel Architects en participant au concours de projets pour la rénovation et l’agrandissement du Musée royal de l’Afrique centrale. Sa réponse: avec respect et humilité d’une part, mais d’autre part en créant également un dialogue. Et ce dialogue a lieu aussi bien en surface qu’en sous-sol.
Il est impossible de voir ce projet autrement que dans une perspective historique plus large. Le musée a été érigé sur l’initiative du roi Léopold II en tant qu’instrument de propagande pour son aventure personnelle au Congo. Après sa mort, l’établissement s’est développé en musée et en institut de recherche sur l’Afrique centrale. En d’autres termes, l’endroit parfait pour nous rappeler l’époque coloniale. Ce site renferme des bâtiments construits dans différentes périodes: le premier musée était abrité par le palais des Colonies, que l’on avait bâti, tout comme son jardin français attenant, à l’occasion de l’exposition universelle de 1897. C’est en 1910 que le bâtiment muséal a vu le jour sous l’égide de l’architecte Charles Girault, et en préparation à l’Expo ’58, le CAPA, ou « Centre d’accueil du personnel africain », est venu s’ajouter au complexe. Le CAPA a été transformé plus tard en un nouveau centre de recherche et d’archive.
En chargeant son architecte personnel Charles Girault de ce projet, Léopold II voulait créer de nouveaux espaces susceptibles d’abriter ses collections grandissantes provenant du Congo. Charles Girault développa un plan directeur pour ce qui allait devenir la Cité coloniale: autour du jardin français, il prévoyait un nouveau bâtiment servant de musée, un centre de congrès et de documentation et une école mondiale. Seul le musée a été réalisé. Au fil des ans, la collection a continué de se développer, mais comme aucun endroit n’était assez grand pour l’exposer en entier, elle a dû être disséminée sur tout le site. Le MRAC a alors exprimé le souhait de redorer, au niveau international, le blason de son musée et centre de recherche sur l’Afrique centrale, et a formulé pour cela un appel à projets en 2006. Dans son concept, Stéphane Beel Architects a repris le plan directeur de Charles Girault. Ils trouvaient important de recréer un tout avec le site, redonnant à chaque bâtiment son identité propre.
Ils ont donc décidé de regrouper les fonctions. Pour le bâtiment abritant le CAPA, utilisé comme centre de connaissance, ils ont conçu une tour dans laquelle on pourrait conserver les collections dans des conditions optimales. La voie d’accès vers le site, le palais des Colonies, a été dégagée pour pouvoir remplir à nouveau cette fonction. En gardant la salle des fêtes et en y ajoutant une médiathèque et un centre de congrès. De cette façon, le musée, qui allait être agrandi pour abriter des expositions temporaires, allait pouvoir revenir à son rôle exclusif de lieu d’exposition. Pour cela, il allait falloir montrer plus d’objets de la collection permanente que les 4 % qui étaient exposés jusque-là. Les fonctions secondaires du musée ont par conséquent été déplacées dans un nouveau bâtiment. L’architecte de projets Maarten Baeye de Stéphane Beel Architects s’est également penché sur l’idée d’un espace de dialogue et de discussion. Un musée actuel doit regarder plus loin que seulement dans le passé. Il doit aussi mettre en lumière l’Afrique contemporaine. Cette fonction, ils la voyaient mieux se déployer dans un nouveau cadre que dans un bâtiment qui, du fait de son architecture festive, évoquait fortement le passé. L’accès au site faisait également partie des éléments qu’ils voulaient réhabiliter. Pour cela, Léopold II avait fait construire un axe de circulation de Bruxelles à Tervuren avec une entrée au site passant par la Tervurenlaan, permettant au public de commencer en beauté sa visite en longeant l’impressionnant palais des Colonies néoclassique et en découvrant depuis là les jardins classés et les autres bâtiments. Pour Stéphane Beel Architects, ce concept a représenté un point de départ important pour la première phase du plan directeur, qui consistait à agrandir le musée et implanter le nouveau pavillon d’accueil. Le fait de placer ce pavillon entre le palais des Colonies et l’ancien bâtiment muséal a permis de renforcer le long axe d’implantation des diverses constructions. Il a été minutieusement aligné avec la façade du musée et se trouve exactement sur la frontière entre le jardin français et le Drevenpark qui entoure le palais des Colonies. Ce bâtiment reflète très fortement le renouveau, comme le souhaitait le MRAC. De plus, avec sa position et son apparence, il minimise l’impact exercé sur les environs protégés.
Le lien entre l’accueil et le musée se matérialise sous terre. De cette façon, Stéphane Beel Architects a réussi à agrandir le musée sans pour autant augmenter son impact sur l’environnement. 70 % de l’extension se trouve à présent sous terre, ce qui permet également de maintenir l’équilibre énergétique du site. Seuls des éléments peu élevés en béton, tels que l’escalier de secours et le podium sur la terrasse du pavillon d’accueil, font allusion à ce qui se passe en dessous. De la même manière, ils adoptent une attitude modeste par rapport au passé (controversé). L’accès ne s’effectue plus par l’imposante entrée, en passant par le grand rond-point à l’avant du bâtiment, mais par les catacombes, le long du -1. Cette réinterprétation peut être vue comme une note critique de l’architecte en marge de l’architecture d’origine.
Afin de maintenir le niveau d’énergie en équilibre, le bâtiment du musée a été entièrement rénové et restauré avec l’ajout – bien dissimulé – de toutes les nouvelles techniques. Par exemple, une double paroi de verre a été placée derrière les ouvrages de menuiserie, procurant ainsi au bâtiment une enveloppe améliorée sans dénaturer le monument et sa valeur intrinsèque. Le bâtiment raconte déjà une histoire, c’est pourquoi la vue devait être préservée autant que possible. Les murs extérieurs en pierre naturelle, les sol et parois intérieurs recouverts de marbre, les parquets, les plafonds en stuc et les peintures murales: tout a été soigneusement nettoyé et au besoin, restauré.
Pour le pavillon d’accueil, on a choisi une structure d’acier et l’utilisation maximale de verre. Un volume de béton noir a été coulé à l’arrière, il abrite à présent toute la circulation verticale, les parties sanitaires et la gaine de ventilation. Comme dans la cuisine d’un restaurant. Cette nouvelle construction s’entend comme une fenêtre transparente vers le précieux site alentour. Au rez-de-chaussée, le nouvel accueil et la boutique du musée ont une vue sur le parc. Au premier étage, les visiteurs du restaurant jouissent d’une vue panoramique du jardin français et du bâtiment muséal. Des fenêtres coulissantes accentuées dans les façades forment un cadre pour la vue la plus importante, celle de l’extérieur depuis l’intérieur. Un détail intéressant de la matérialisation est la récupération des arbres qui avaient dû être abattus pour la rénovation. On les a utilisés pour produire le bois de placage qui recouvre à présent les meubles. Au sous-sol aussi, la lumière et la vue sont d’une importance cruciale. Le long du pavillon, on a installé une cour anglaise avec des panneaux de béton blanc qui catalysent la lumière. Ainsi, les visiteurs qui parcourent la longue galerie publique n’ont jamais l’impression de se trouver à dix mètres de profondeur. Le fleuron de la construction est l’énorme pirogue qui accompagne le passage de l’accueil au musée. C’est un peu comme si l’on traversait en bateau les trois salles d’expositions temporaires pour aller vers la cour encaissée du vrai musée. Les salles d’expositions temporaires brillent par leur fonctionnalité. Elles peuvent être divisées en un auditorium et deux salles séparées, mais aussi transformées, à l’aide d’une paroi mobile et pivotante, en une grande salle d’exposition unique. Un circuit de logistique parallèle se trouve de l’autre côté et se prolonge jusque dans les caves du musée, permettant une circulation bien séparée des personnes: les employés qui préparent de nouvelles expositions peuvent aisément travailler sans déranger les visiteurs. Leur parcours comprend naturellement la zone de chargement et de déchargement munie d’un ascenseur assez grand pour transporter des objets très volumineux, ainsi que la zone technique et l’espace de stockage. La matérialisation accompagne ici aussi l’accès à la lumière et l’entrée au musée. De bas en haut, on peut voir un parterre de terrasse qui évolue graduellement du blanc au gris puis au presque noir.
La transition du nouveau à l’ancien s’effectue par le biais d’un escalier ouvert qui offre une vue vers et depuis les bâtiments et où les visiteurs passent deux fois. À ce niveau de la cour encaissée, on peut visiter l’exposition permanente de référence et s’informer ainsi sur l’histoire de l’institut et du musée ainsi que sur les activités du MRAC jusqu’à aujourd’hui. Pour la scénographie, on a fait un usage abondant des vitrines existantes, complétées d’un système modulaire de plateformes permettant de raconter une nouvelle histoire, d’une façon moderne. Les vitrines d’origine ont été restaurées et munies d’un socle technique et d’un plafond percé de lumières. On les a ensuite replacées à leur emplacement initial. Ainsi, les axes de vue de l’époque ont pu rester intacts.
On a aussi pensé aux tout petits. Les ateliers pour enfants, autrefois discrètement tenus au grenier, ont été déplacés vers les fondations du bâtiment. Près de l’atelier de musique, mais à l’avant, où la lumière naturelle se fraie un chemin et le jardin français est pour ainsi dire à portée de mains. Le grenier a été réaménagé comme bureau ouvert. Au moment où cette première phase se conclut, on peut voir l’émergence d’une nouvelle ère pour ce musée, qui servira, espérons-le, de catalyseur pour les autres phases nécessaires du plan directeur. Le dialogue avec le site est déjà engagé, il est souhaitable qu’il puisse se poursuivre.
Texte: Sam Paret
Photos: Luca Beel